Réseau des jardins solidaires méditerranéens
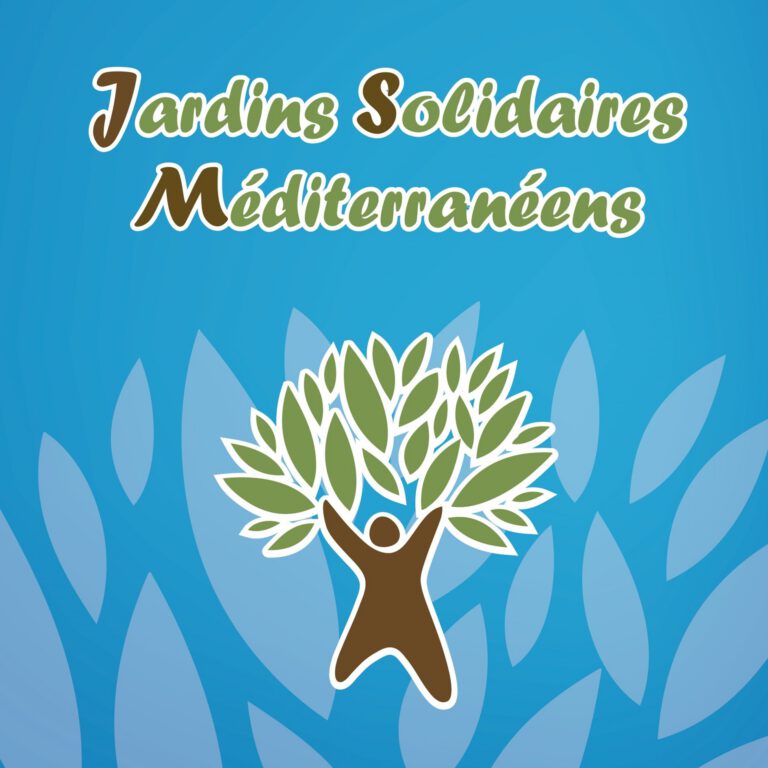
Initié en 1999, ce projet correspond à un réseau dynamique de jardins partagés disposant d’un grand nombre d’adhérents. Cette initiative permet de mettre à disposition de ces derniers différentes formations et de participer aux nombreuses activités mises en place.
Auteurs(s)
Programme
Démarrage : 1999
Lieu de réalisation : Charleval, PACA
Budget : 70000
Origine et spécificités du financement : Région, DREAL, subventions
Organisme(s)
Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens
Charleval – 13350BP 20017 4 cours de la République
ORIGINE ET CONTEXTE
Les jardins partagés sont apparus dans les années 90 en Amérique du nord et au Canada. Ils ont été ensuite développés en France comme une alternative aux jardins traditionnels (jardins ouvriers et familiaux) qui étaient parcellés et qui comprenaient des barrières. Le Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens a été initié en 1999. Il s’agissait au début de discuter de façon informelle sur des problématiques communes aux différents jardins, ainsi que de partager les expériences entre les différents animateurs de jardins partagés. Initiée en 1999 l’association Réseau des Jardins Partagés Méditerranéens (RJSM) se structure en 2006 et une charte des jardins partagés est rédigée en 2010.
Objectifs
– Relier les jardins afin de s’aider les uns les autres, de se former ensemble, de gagner plus de poids face aux pouvoirs publics et de sensibiliser un maximum de personnes.
Le réseau est ouvert aux jardins qui respectent la charte du Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens.
ACTIONS MISES EN OEUVRE
– Le RJSM organise des rencontres-échanges et des visites de jardins ouvertes à un large public.
– Organisation de formations en horticulture thérapeutique, sur la création et l’animation de jardin en partage, etc.
– Transmission de conseils, partage des savoir-faire, apports d’expertise et aide au montage de projets de jardins partagés.
– Partage d’information sur les activités menées dans chaque jardin adhérent du réseau.
– Sensibilisation des pouvoirs publics pour favoriser l’émergence d’une politique en faveur des jardins partagés.
– Le RJSM est membre du Réseau National des Jardins Partagés.
– Participation active à plusieurs projets européens (EUGO, GARDENISER, Volontariat seniors, etc.).
Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs
– Le Réseau a recensé plus de 100 jardins partagés sur son territoire dont une cinquantaine a adhéré au Réseau. Une vingtaine de structures ou de « personnes ressources » gravitent autour des activités menées par le Réseau.
– Les jardins partagés peuvent être collectifs ou mixtes (1 partie collective + 1 partie avec parcelles individuelles), il existe toutes sortes de configuration, certains sont pédagogiques, d’autoproduction, d’insertion sociale ou professionnelle et également thérapeutiques. Le contexte guide souvent la thématique mais un des objectifs premiers est le lien social car dans un jardin on ne cultive pas que des légumes.
– Les rencontres-échanges ont eu lieu dans tous les départements de PACA
– Le Réseau emploie 2 salariées en contrat aidé (20h/semaine pour la Chargée de communication et 30h/semaine pour la Chargée de développement) et chaque jardin implique des emplois (animateurs ou personnes en insertion)
-Les différentes formations proposées sont des formations socle elles réunissent une quinzaine de personnes en moyenne et ont lieu 1 à 2 fois par an chacune. La formation « Créer et animer un jardin en partage » est actuellement en cours de refonte : elle durera 13 jours au total répartis sur 4 sessions par an (1 chaque saison), avec la possibilité d’assister uniquement aux modules que l’on souhaite suivre.
La formation « Découverte de l’horticulture thérapeutique » s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent utiliser le support jardin comme un outil de soins.
-Ces formations s’adressent à des publics variés : particuliers, personnes qui veulent créer un jardin thérapeutique, public venant de l’étranger (Tunisie, Belgique, etc.), collectivités adhérentes au réseau (par exemple Grasse), etc.
-Un partenariat a été créé avec le GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique) sur l’expérimentation de semences anciennes dans certains jardins partagés.
-Participation aux rencontres organisées (2 jours, 4 fois par an) par le Réseau National des Jardins Partagés qui permettent d’échanger et de s’informer des actions menées dans les autres régions françaises.
-Projet EUGO (Projet de « recherche-action » European Urban Garden Otesha) : a été monté par 6 partenaires européens dans le cadre des « Multipartenariat Gruntwig ». L’aboutissement de ce projet de deux ans (2012 – 2013) est l’ouverture d’une plateforme internet d’apprentissage en ligne (e-learning) sur les jardins partagés (Urban Community gardens). De nombreuses vidéos des différentes expérimentations qui ont été menées dans les jardins sont proposées, comme par exemple, une vidéo sur la construction d’un « four à pain en terre paille » dans un jardin des Alpes de Hautes Provence. Le RJSM a réalisé un catalogue illustré des bonnes pratiques consultable et/ou téléchargeable sur le site.
-Projet GARDENISER (visant la création d’une formation professionnelle d’animateur de jardin partagé menée d’octobre 2013 à déc. 2015) : 19 participants de 5 pays européens ont participé. La première rencontre a eu lieu à Aix-en-Provence en 2014. Dans un 1er temps, le RJSM et ses partenaires européens ont constitué des groupes de 20 à 30 formateurs pour travailler à adapter les modules et les outils de la formation existante. Dans un 2ème temps, la version européenne de la formation, issue de ce travail, sera testée dans chaque pays auprès d’une quinzaine d’animateurs.
– « Volontariats seniors » entre la France et le Royaume Uni : 6 seniors français sont partis 3 semaines à Cornouailles, 6 seniors anglais ont été accueillis dans les jardins de la région PACA, ce qui a permis un échange de bonnes pratiques sur le terrain.
Originalité
La formation phare du Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens est celle sur la découverte de l’horticulture thérapeutique car très peu de formations de ce type existent en France. Ce Réseau, qui rassemble de nombreux jardins partagés, leur permet de participer ensemble à des projets de plus grande envergure au niveau européen. Il adhère à d’autres réseaux et transmet les informations aux membres. Il permet également la création de pont avec la recherche.
Partenariat(s)
Réseau National des Jardins Partagés, GRAB Groupe de Recherche en Agriculture Biologique, CPIE, collectivité locale (Grasse), collectivité territoriale (La Ciotat), etc.
Retour d’expérience
Difficultés et/ou obstacles rencontrés pendant la mise en œuvre :
(1) Entre la pression foncière et le manque de volonté politique, il est difficile de créer un jardin partagé. Il faut en moyenne 2 ans entre l’idée et le projet.
(2) Faire en sorte de maintenir la dynamique et la mobilisation des personnes.
Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles :
(1) Se rassembler pour peser auprès des collectivités territoriales
(2) Se mettre en réseau pour maintenir les liens et se remotiver. Les rencontres-échanges permettent de « se ressourcer auprès d’un autre jardin et se redonner du cœur à l’ouvrage et de l’énergie pour poursuivre les actions ». Utilisation des « Google group » pour diffuser les informations.
Améliorations futures possibles :
Liées à la diversification des financements : développer les prestations pour la création et l’animation de jardins et éventuellement lancer des projets avec des financements participatifs.
Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou un essaimage :
Dynamique de réseau : entraide entre les personnes et possibilité de pouvoir compter sur les autres.
Partager sur
Copyright: Licence Creative Commons Attribution 3.0
Pour citer un texte publié par RESOLIS:
Petit Monique, « Atelier 44, un atelier de menuiserie où l’esprit et le geste ne font qu’un », **Journal RESOLIS**