Le pouvoir d’agir en France selon Asmae
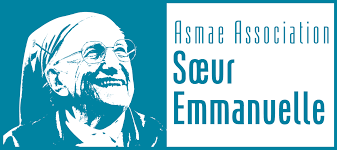
Pour renforcer les capacités d’agir des habitants des quartiers populaires, l’association de Sœur Emmanuelle a conduit une expérimentation de 2001 à 2018 en région parisienne : « Divers-Cité ». Ce programme repose sur l’organisation communautaire et s’inscrit dans la durée.
Auteurs(s)
Programme
Démarrage : 2001
Lieu de réalisation : Seine-Saint-Denis, 19e arrondissement et Asnières-sur-Seine
Origine et spécificités du financement : AG2R la mondiale, collectivités territoriales, Fondation de France, Fondation Vinci pour la cité, ICF Habitat la sablière, Paris Habitat et SC Johnson
Organisme(s)
Asmae
Montreuil – 93100259-261 rue de Paris (immeuble Le Méliés)
•
ORIGINE ET CONTEXTE
De 2001 à 2018, Asmae, ONG de solidarité internationale française spécialisée dans le développement de l’enfant, a mené le programme « Divers-Cité ». Ce programme s’inspire des années de vie en Egypte de sa fondatrice, Sœur Emmanuelle, durant lesquelles elle a été témoin de la capacité des communautés locales (les chiffonniers) à résoudre eux-mêmes leurs problèmes. L’essence du programme est d’intervenir directement auprès des habitants autour d’une aspiration fédératrice commune, le plus souvent les enjeux d’éducation et d’épanouissement des enfants.
Objectifs
– Renforcer les capacités des habitants et plus particulièrement des parents
– Permettre aux gens de s’organiser autour d’un objet commun
– Devenir des acteurs de quartiers
ACTIONS MISES EN OEUVRE
Critères de sélection de la zone d’intervention : zonage du politique de la ville ; inaccessibilité ou très faible accès aux instances (ex. conseils de quartier ou association de parents d’élève) ; et sollicitation extérieure (ex. bailleurs sociaux (le plus souvent), club de prévention, collectif déjà accompagné, travailleurs sociaux ou encore centres sociaux pour de la formation aux professionnels)
Une équipe de 2 agents de développement social et communautaire et 1 coordinatrice accompagne la structuration de collectif d’habitants, selon une méthode en 4 étapes.
1. Appuyer la mobilisation
– Constituer un 1er groupe autour d’une action fédératrice
– Partir des ressources, des aspirations et des envies des personnes
– 1ère prise de contact avec le territoire : via un bailleur qui n’arrive pas à mener à bien sa mission sociale avec les publics éloignés ou un gardien
– Au démarrage, l’agent crée les conditions (ex. repas ou fête de quartier) et identifie les forces vives.
2. Structurer le collectif
– Consolidation d’un groupe moteur (3 à 5 personnes)
– Clarification de l’objet du collectif
– Mise en place d’actions collectives et régulières (ex. soutien scolaire, cours de français, sorties…)
– Identification du collectif par ses pairs
3. Appuyer le collectif dans la négociation d’alliances avec les institutions et les élus
Mobilisation de personnes ressources du territoire pour apporter leur soutien
4. Renforcer les fonctions ressources
Mise en place d’actions d’appui (ex. recherche de financements, démarches administratives et comptables…)
Séminaire annuel l’été pour réunir tous les collectifs
Résultats et impacts, quantitatifs et qualitatifs
Voir Rapport d’activité 2018 – type d’indicateurs utilisés : nombre de bénéficiaire, nombre d’événement organisé, nombre de participant (bénéficiaires indirectes), autonomie des mères de famille, baisse de dégradation de l’environnement…
– Etude d’impact annuel par LM conseil – dans le cadre d’une recherche-action
– Multiples effets induits (ex. vivre ensemble)
– Pour les collectifs les plus anciens : création d’une association (l’informalité des collectifs peut déranger les collectivités) et embauche de contrat adulte relais (3 ans renouvelable 3 fois), certains de ces postes sont tenus par des femmes n’ayant pas été à l’école en France (analphabète ou illettrée)
Originalité
« Divers-Cité » se distingue à 2 égards : d’une part, il propose un appui organisationnel basé sur une approche communautaire* qui est très peu employée en France ; et d’autre part, il intervient en décalage des autres acteurs locaux, c’est-à-dire aux créneaux horaires où les habitants sont davantage disponibles (cf. soirées et weekends).
* L’organisation communautaire est le processus par lequel un groupe de personnes vivant sur un même territoire s’investit ensemble pour améliorer des situations qu’il considère insatisfaisantes.
Partenariat(s)
De nombreux partenaires parmi lesquels : Réseau Pouvoir d’Agir et Réseau du Séminaire pour la Promotion des Interventions Sociales Communautaires (SPISC)
Retour d’expérience
Difficultés et/ou obstacles rencontrés pendant la mise en œuvre :
– Émiettement du financement du développement local à Paris : multiplicité des acteurs et des initiatives, absence d’une vision d’action globale et mise en concurrence des acteurs
– Trouver les réseaux de pairs
– Insuffisance des études d’impact pour démontrer l’efficience du dispositif
– Besoin de visibilité et de légitimation, notamment vis-à-vis des financeurs
– Lourdeur administrative des financements publics
– Assimilation au bailleur social qui a sollicité l’intervention, entraînant la perte de neutralité
– Enjeu de la transmission du leadership (cf. turn over dans le collectif)
Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles :
– Intégrer l’expérimentation de Réseau Culture 21
– Certains collectifs accompagnés sont devenus des associations et peuvent alors accéder aux financements de la ville.
Améliorations futures possibles :
– Imaginer de nouveaux modèles de solidarités avec les habitants des quartiers populaires, notamment pour sortir des logiques de segmentations des collectivités qui sont délétères pour les dynamiques des collectifs.
– Valoriser davantage les réalisations des collectifs
Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou un essaimage :
* TROUVER UN COMMUN FEDERATEUR : Rien n’est proposé (facteur de réussite important). Il ne s’agit pas d’une approche projet ni d’une solution clé en main. Les agents laissent aux habitants leurs capacités d’agir et se basent sur les outils et compétences dont ces derniers disposent, ainsi que leurs spécificités culturelles des habitants.
* ADAPTATION : Les accompagnements s’adaptent au contexte d’intervention du programme. Ce sont les habitants qui décident.
* ANCRAGE TERRITORIAL : Pour qu’un collectif fonctionne, il faut qu’une personne habitant le quartier se sur-investisse. Les agents se déplacent beaucoup : leurs bureaux sont les locaux des associations (les plus souvent dans leurs murs), les appartements des habitants ou fête de quartier.
* PARTENARIAT : De nombreuses alliances sont nouées mais pas forcément sous forme de conventionnement qui peut être contraignant.
* TEMPS LONG : Le principal écueil à éviter est d’aller trop vite pour constituer le collectif. En moyenne, 2 à 6 mois sont nécessaires pour assembler un groupe moteur.
* GRATUITE : Les accompagnements des collectifs sont entièrement gratuits et Asmae ne leur met pas d’argent à disposition.
Idées de sujet(s) de recherche fondamentale ou appliquée, utile(s) pour le présent programme :
Mettre au point une méthodologie pour mesurer différemment les effets et faire ressortir l’efficience de programme éminemment qualitatif
Pour en savoir plus
Membres de l’équipe :
Chloé Alauzet, ancienne agent de développement social et communautaire
Christophe Jibard, ancien agent de développement social et communautaire
Partager sur
Copyright: Licence Creative Commons Attribution 3.0
Pour citer un texte publié par RESOLIS:
Petit Monique, « Atelier 44, un atelier de menuiserie où l’esprit et le geste ne font qu’un », **Journal RESOLIS**